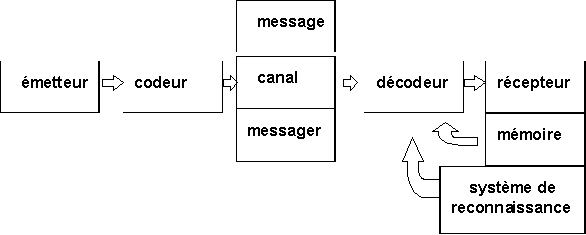
Jakobson et les fonctions du langage
La communication a pour objectif chez un sujet de modifier l'état du destinataire : soit l'état cognitif, soit l'état affectif soit encore les dispositions à l'action et l'action même.
Roman. Jakobson est un des plus grands maîtres de la linguistique du XXe siècle. D'origine russe, il émigra en 1941 aux Etats Unis et il a exercé, et continue à exercer, une grande influence sur la linguistique. Son oeuvre, nombreuse et variée, porte bien sûr sur tous les domaines de la linguistique, et ses travaux approfondissent notamment l'étude des rapports entre la structure du langage et la théorie de la communication, mais débordent souvent la linguistique au sens strict du terme. De Braque, par exemple, il cite la phrase "je ne crois pas aux choses, mais aux relations entre les choses".
Un modèle général de la communication peut être décrit ainsi : la communication est le transfert d'informations entre un émetteur et un récepteur, joint par un canal (air, ligne téléphonique, lettre, journal etc...) grâce à des messages. Ces messages sont mis en forme par l'émetteur grâce à une opération de codage et sont identifiés par le récepteur grâce au décodage, cette opération ne pouvant se faire que si le code leur est commun.
Roman Jakobson utilise ce modèle, dans son essai de linguistique générale publié en français en 1963, pour définir six facteurs qui caractérisent la communication verbale :
le locuteur : le destinateur (l'émetteur, "l'encodeur") c'est la personne qui parle.
l'auditeur : le destinataire (le récepteur, "le décodeur") c'est la personne qui reçoit le message.
le message (l'énoncé, la phrase, l'argumentation..)
le code (par exemple la langue française dans le cadre de notre recherche)
le contexte ou référent, appartenant à la situation qui donne lieu au dialogue ou à la discussion en cours,
le contact ou canal (l'air, la ligne téléphonique, la page écrite...)
Ce que l'on peut clarifier selon le schéma suivant : (D’après Joël de Rosnay, dans Pourquoi Comment des activités audiovisuelles 1984, PEMF, p11).
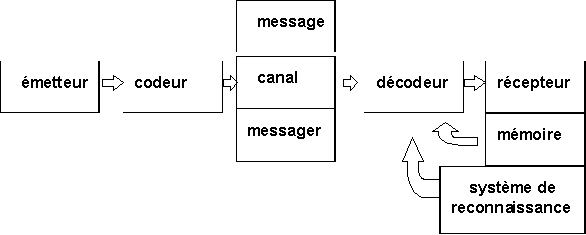
Dans un débat, le locuteur s'oppose à l'auditeur, mais chacun, dans une telle discussion, peut être alternativement locuteur et auditeur, ce qui suppose une attitude différente en face du code, selon que le message est encodé en vue de la production pour l'émission, ou décodé en vue de la reconnaissance.
Jakobson a montré que le message est spécifié dans sa nature par l'insistance que l'émetteur porte:
soit sur ses propres affects (fonction émotive),
soit sur les signifiés (fonction référentielle),
soit sur le message dans sa forme intrinsèque (fonction poétique),
soit sur le destinataire (fonction conative).
Il s'ensuit qu'on doit reconnaître le poids du message, de l'effet produit sur le destinataire, que l'on reste au niveau cognitif pour véhiculer de l'information ou convaincre, ou qu'on le déborde pour susciter l'affect. Mais comme nous l'avons vu, le sujet est tour à tour locuteur et auditeur, celui-ci peut se demander " quelle image de moi se fait celui à qui je parle " et " quelle image de l'autre sous-tend le discours que je lui adresse "; ce qui fait appel à ce que l'on peut nommer le " feed-back ".
Ceci pour montrer que lors d'échanges oraux, l'enfant locuteur-émetteur, le Je qui envoie un message à son (ou ses) pair(s), auditeur-récepteur, le Tu qui l'écoute, qui l'entend, qui essaie de le comprendre, deviendra à son tour un Tu, lorsque son récepteur prendra le rôle locuteur-émetteur pour lui répondre et lui dire à son tour Je. Ce que résume si bien Edgar Morin lorsqu'il dit : " Dans la vie, il y a Moi, et il y a l'autre. Il faut pratiquer une pédagogie de l'autre qui est un autre soi-même et un soi-même autre ".